 |
Une
fois l’Empire colonial effondré, que
devient la petite île ? Veut-elle s’en retourner
à son passé glorieux
mais confisqué et veut-elle enfler ses mythes pour les
vendre à l'encan ?
|
Chute
de la Maison Corse et travail de deuil
1962
et la fin de la guerre d’Algérie
marquent la fin de l’Empire corse.
De ce moment, l’île redevient une
petite île, son horizon se rétrécit.
L’heure des bilans sonne et l’absence de
facteur intrinsèque de développement se manifeste
sans que les revenus de
substitution aient la possibilité de compenser le retard de
l’île par rapport
aux autres provinces françaises. Cela ressemble plus
à une terre à l’abandon
qu’à une terre à exploiter
d’autant que le déficit démographique
est indéniable
alors même que le repeuplement de
l’après 1962 s’effectue sans
revivification
de l’espace rural, perçu comme l’espace
traditionnel de la véritable Corse.
L’intérieur ne se repeuple pas, le littoral
s’urbanise et se dote d’une population
urbaine diversifiée ou d’installations que
certains qualifient de
latifundiaires en faisant ainsi un contresens, alors qu’il
s’agit d’exploitations
intensives à la productivité agricole accrue par
la mécanisation que la plaine
permet, au rebours des exploitations maraîchères
de montagne. Sont installés
sur ces terres inexploitées jusqu’alors, des
ouvriers agricoles emmenés par les
rapatriés d’Algérie, et
voilà une population éminemment
allogène, installée sur
des terres dont on estime que les Corses sont spoliés.
Si la
colonisation de peuplement chère à nos modernes
corsistes fait référence à
cette population d’ouvriers agricoles, elle se colore
d’une teinte autant
raciste que xénophobe. Si elle renvoie aux
Français, rapatriés ou venant du
continent, elle s’égare dans une
interprétation tendancieuse des mouvements
démographiques en jetant pêle-mêle dans
cette catégorie des fonctionnaires
continentaux en poste pour quelques années seulement, et
connaissant un fort
taux de rotation des affectations, des conjoints de Corses (quel
degré
d’ethnicité corse faut-il retenir
s’agissant des enfants des couples
mixtes ?), les rapatriés d’Afrique du Nord enfin.
Mais loin d’être un
peuplement, il vaudrait mieux parler d’un peuplement de
substitution à
l’accroissement naturel et c’est moins les autres
qui arrivent que les Corses
qui ne reviennent pas hormis ceux des Colonies.
Pour
en finir avec cette notion de colonie de peuplement, notons ces
quelques
vérités. En Corse comme sur le Continent, on
observe beaucoup de mariages
mixtes qui sont chose rare et mal vue dans les
colonies du
monde réel. Le mouvement naturel affectant
l’île depuis deux siècles était celui
d’un relatif dynamisme démographique
jusqu’à la crise agricole de la fin du
XIXè siècle, comme partout ailleurs, mais la
saignée de la première guerre
mondiale accentuée par la participation à l’aventure coloniale
renforce le renversement de
tendance. La remontée des années soixante est
certes due à un mouvement
migratoire mais, passé le choc du retour des
Français d’Algérie dont certains
sont aussi des Corses, aucune autre tendance au retour des Corses dans
l’île ne se
manifeste, les conditions d’une attraction
économique positive étant
obérées
par l’acharnement des Corses eux-mêmes à
rendre l’île inintéressante (on
n’attire
pas les mouches avec du plastic). Loin d’être une
dernière colonie de la
France, la Corse partage tout simplement le sort commun des
régions
d’agriculture insuffisamment productive, notamment en zone de
montagne mais sans
le ressort touristique des sports d’hiver ou de la
micro-industrie de pointe,
dans leur lente insertion
dans un ensemble économique plus vaste, celui de
l’Etat-nation. A maints
égards, le sort d’un département comme
celui de
l’Aveyron est très semblable.
On y observe comme en Corse l’interruption de productions
locales, la fermeture
progressive des exploitations minières et la
prépondérance des petites
entreprises. Cette situation est aggravée par
l’étroitesse du marché
interne ; de tout cela s’en suit l’exode
des
populations vers les centres
dynamiques d’activité industrielle et tertiaire
avec son
corollaire, l’érosion
de la spécificité régionale et
l’adoption
d’un modèle fédérateur
consumériste,
au niveau national (et plus tard au niveau européen, voire
mondial). La Corse
manifeste son ressentiment mais se trompe de cible, derrière
la
France c’est
bien d’une uniformisation mondiale qu’il
s’agit.
Ce
discours sur la colonisation de la Corse, ou la colonisation de
peuplement,
n’est même pas nouveau ; il reprend le
discours ethniciste des muvristes
en les habillant des oripeaux tiers-mondistes, qui seuls permettent de
suivre
les mêmes chemins de traverses que
l’irrédentisme culturel, après son
suicide
politique pendant l’occupation italienne.
Les
commentateurs et parfois les hommes politiques ne restent pas
insensibles à ce
thème de la singularité de
l’île, alors même que tout ce que nous
venons de
voir jusqu’à présent va dans le sens
d’une singulière absence de
singularité.
Ici ou là, on accepte d’une certaine
manière d’accuser un deus
ex-machina qui aurait émasculé la
société corse. Là se
situerait le statut colonial de
l’île. La Corse serait comparable à une
colonie parce qu’elle n’a pu accéder
à
l’Etre-Nation par la faute des Autres, ce qui explique un
retard économique qui
la distinguerait des autres régions à priori
comparables. Le diagnostic est
loin d’être nouveau mais il est faussé
et il est dommage que là comme ailleurs
le discours passe sans qu’on daigne le redresser.
L’assoupissement de
l’île pendant
l’après-guerre
A
l’heure où les autres provinces se reconstruisent,
la Corse semble entrer dans
une longue période d’assoupissement ; il
est vrai que l’immédiat
après-guerre connaît le déclin
démographique le plus prononcé depuis deux
siècles. Avec 145000 habitants, sa densité la
situe en queue des régions
françaises, même si, malgré ce qui se
dit ici ou là, elle n’a jamais
été une
région dense. Le dépeuplement s’inscrit
dans une perspective longue qui touche
d’autres régions dans le cadre d’un
élargissement des économies-monde pour retenir
les catégories de Fernand Braudel, où la Corse de
situe dans le premier cercle
de la périphérie. Mais loin
d’être le premier cercle de l’Enfer,
celui de la
périphérie coloniale, son positionnement assimile
l’île au dernier cercle du
Paradis, celui des régions métropolitaines,
rurales et montagneuses, à quoi
l’insularité impose une contrainte de plus.
Reprenons le fil de
l’Histoire.
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, la
Corse, c’est un truisme de le dire, est une
société paysanne, une
société close dont les seules perspectives de
développement sont à trouver hors
d’elle-même ; en effet, les ressources
autochtones sont les activités agro-pastorales, sachant que
l’activité
industrielle a connu un développement erratique
contrecarré par la faiblesse et
parfois la mauvaise qualité des ressources, en tout cas
l’impossibilité de son
adaptation au progrès technique et aux exigences de
rendement (rappelez-vous
l’aventure des forges insulaires). Comme dans les autres
régions rurales
françaises, la crise agricole du tournant du
siècle bouleverse le milieu
socio-économique de l’île.
L’appel de l’extérieur (fonction
publique française,
armée coloniale, industries du continent dans une moindre
mesure) bat son
plein, en conséquence, l’émigration
augmente considérablement, ce qui a pour
effet de surmonter les effets de la crise, sans doute mieux que dans
d’autres
régions, en répondant aux attentes de promotion
sociale et d’intégration des
Corses à un niveau qui pourrait faire des envieux ailleurs.
La contrepartie ne peut
étonner ; cela se traduit par le sous-peuplement,
et la destruction
presque complète de l’économie locale
traditionnelle bien avant les effets de
la première guerre mondiale et la ponction sur la population
masculine. C’est
d’ailleurs la déprise agricole qui fausse la
perspective en faisant imputer à
la Grande Guerre la chute démographique et ses implications
multiples alors que
cette baisse débute dès 1890. Par un renversement
de raisonnement, on en déduit
que, oui, vraiment la Corse a payé plus cher que les autres
régions,
d’ailleurs, voyez combien sa population a baissé.
La comparaison avec la
Sardaigne joue alors à plein : et de comparer les
effets de
« l’occupation
française » à la situation
plus dynamique de la
voisine du sud, en faisant l’impasse sur les conditions
spécifiques aux deux
îles ! Là encore, ce thème est
un lointain écho aux thèses muvristes qui
dénonçaient l’action de la matrigna
(marâtre France) comme étant responsable de tous
les maux et qui exaltaient la
politique italienne de Mussolini en Sardaigne et en… Albanie.
Quant à prétendre qu’avant
l’entrée de
la Corse dans le giron français, la
Corse était une des régions les plus denses
d’Europe c’est un pur
mensonge : avant la guerre de Trente ans, l’Alsace
était quatre fois plus
dense, de même, le Nord ou le lyonnais, des
régions qui,
effectivement, seront
au rendez-vous de la révolution industrielle et du
développement économique un
siècle après. Si, en revanche, on se limite aux
îles méditerranéennes, la
situation Corse est loin d’être
significative : la
Sicile est l’île la
plus dense depuis longtemps, quant à la Sardaigne, souvent
prise
comme
référence, sa densité ne
décolle vraiment
qu’au début du vingtième
siècle, le
décrochage Corse se produisant à ce moment, soit
après cent trente années de
présence française. Opposer la
présence italienne
à la présence française sous
le seul angle de la densité est un raccourci qui me semble
particulièrement…court !
En fait, on l’a compris,
la
population s’en va, elle ne meurt pas. En effet, le solde
naturel est encore
positif jusqu’au milieu du XXè siècle,
même si ce n’est plus avec la même
ampleur qu’auparavant en raison de la chute de la
natalité. De ce point de vue,
la Corse suit le mouvement général que
connaît le Continent., dans ces régions
fort comparables que sont les Cévennes, les Alpes du Sud
(pensons aux
Barcelonnettes partis au Mexique), le Rouergue ou la Bretagne.
C’est bien le
solde migratoire fortement négatif qui est en cause. Le
mouvement est d’autant
plus intense qu’il est organisé, pour les emplois
qui ont la préférence des
Corses, comme, à la même époque pour
d’autres régions du Continent où
l’entr’aide fonctionne admirablement .
Ce qui est peut-être typique de l’île est
la mobilisation sans précédent des
réseaux politiques pour échanger emplois contre
bulletins de vote. Ce sont les
notables qui se sont fabriqué un rôle de
médiation avec l’État et les
administrations publiques, en apportant ainsi aux pouvoirs publics les
ressources en hommes que leur clientèle peut offrir, et le
système fonctionne
parce que depuis des décennies, tout au long du
XIXè siècle, les Corses ont
pratiqué l’entrisme dans la fonction publique,
à tous les niveaux et jusqu’aux
plus élevés dans la hiérarchie.
L’accès aux ressources pour la population
locale est donc extérieur ; ces ressources qui font
vivre la famille, la
phratrie et le village, ce sont les emplois bien sûr, mais ce
sont aussi les
subventions. Ces « services », et en particulier,
la gestion des canaux de
l’émigration, sont monopolisés par les
acteurs politiques, pour lesquels
l’assise politique locale dépend de leur
capacité à fournir ces ressources, à
être donc crédibles. Le système se
« professionnalise »
très vite et
n’a jamais eu d’équivalent dans
l’histoire de l’île, puisque celle-ci au
temps
de l’occupation génoise, ne se voyait pas proposer
les mêmes facilités d’accès
aux emplois et aux responsabilités. Ce fut
d’ailleurs l’erreur de Gênes de
tenir les Corses à l’écart des
carrières, poussant les notables à
d’incessantes
guerres de territoires, de partage de clientèle pour des
ressources maigres. Ce
fut l’habileté de la France de faire table ouverte
dès le début, se donnant ainsi
un fort taux de crédibilité.
Très rapidement,
dès le second
Empire, mais avec une accélération notable lors
de la conquête des pouvoirs
locaux par les notables républicains à la fin du
XIXè siècle,
les réseaux d’influence
se constituent en
structures hiérarchisées mettant en relation les
représentants « qui
comptent » à chaque niveaux du territoire
(maires, conseillers généraux,
notabilités locales) et animées par des
« chefs de parti », notables régionaux
souvent parlementaires, et donc capables d’agir au sein de
l’État. Soyons net,
ce que nous ne cessons de nommer « clans » ne sont
rien d’autre que ces réseaux
qui sont, ne nous cachons rien, assez répandus dans les
régions rurales
françaises durant cette période
d’apprentissage de la démocratie. En Corse,
cette phase de démocratie clientéliste dure plus
longtemps qu’ailleurs, voilà
tout.
Le lendemain
de la seconde guerre mondiale sonne le glas de la colonisation, et le
début du
rétrécissement de l’île, qui
voit inexorablement ses ressources externes
diminuer avec la rétraction des emplois dans
l’administration et l’armée
coloniale.
Dans le
même temps, les élites locales
doivent passer la crise de l’après-guerre, et
même si l’épuration fut
modérée,
le cantonnement du pouvoir du parti communiste,
auréolé du prestige dû à son
rôle de leader dans la Résistance, mobilise les
énergies pendant la phase de
reconstruction de la Droite insulaire. Dans la
décennie qui suit le second conflit mondial, alors
même qu’un premier pan
d’Empire s’écroule avec la fin du
protectorat sur la péninsule indochinoise, et
que les premiers retours ont lieu, l’île dort,
rêvant de son économie agropastorale
traditionnelle, mais moribonde et sans avenir, tandis que les Corses ne
s’intéressent pas aux plaines du littoral dont la
démoustication avait pourtant
été faite par l’intendance
américaine pendant le conflit. Les surfaces
cultivées sont ainsi passées de 36 % en 1913
à
5,3 % en 1967 ! L’industrie liée
à l’activité agricole, plus active au
XIXe siècle que l’industrie
métallurgique ou de seconde transformation, avec
des fabriques de savon, de tabac, des verreries, des tanneries, des
moulins à
huile , des distilleries, était quasiment
éteinte, vaincue par la concurrence.
L’ère des
soupçons
La
situation évolue à la fin des années
cinquante, grâce aux politiques
d’aménagement et de développement que
l’Etat décide de lancer, après une
longue
période d’indifférence qui suit la
chute du Second Empire. A cette époque, en
effet, la IIIè République allait
littéralement partir à la conquête de
l’île de
Corse, terre bonapartiste qu’il convient
d’encadrer, et l’effort allait porter
sur la mise en place des relais administratifs territoriaux de
l’État, qui
représentaient dès lors l’essentiel des
ressources en emplois, emplois obtenus
bien évidemment d’autant plus facilement que
l’on est du bon côté.
Toute
cette période jusqu’à tard dans le
siècle suivent, à la fin des années
cinquante, est illustrée par le double langage des groupes
dirigeants locaux
qui sont tout à la fois pourvoyeurs d’emplois
à l’extérieur de
l’île et
contempteurs du système sur l’air du
thème de la « Corse abandonnée
». En
réponse aux demandes pressantes d’aides pour
compenser le handicap de
l’insularité et le retard de
l’île, demandes déjà
exprimées avant-guerre, le
Programme d’action régional de la Corse est
adopté en 1957, en faisant reposer
le moteur du développement sur deux secteurs,
considérés comme les deux atouts
naturels de l’île, le tourisme et la
rénovation de certains secteurs agricoles. La Somivac,
chargée de l’aménagement agricole, et
la
SETCO en charge du tourisme sont créées sous le
statut juridique de société
d’économie mixte, le tout accompagné de
quelques travaux d’amélioration des
infrastructures. La
réponse de l’Etat se
produit tout naturellement en conformité avec le mode de
relation de l’île avec
le Continent, à savoir une logique
d’économie publique, mais ce choix a pour
conséquence de conforter les populations dans un
rôle passif, où l’attentisme a
pour corollaire l’espérance de mannes pour
lesquelles les Corses ne développent
guère de volonté d’entreprendre. Leurs
représentants politiques continuent de gérer
leurs réseaux d’influence
traditionnels en abandonnant aux fonctionnaires de
l’État la responsabilité des
projets de modernisation, et ne montent sur scène que
lorsque des associations,
des représentants syndicaux ou des groupes
d’intérêts locaux pointent le bout
du nez, en risquant par là même de leur ravir le
monopole du dialogue avec
l’Etat.
Que se passe-t-il pendant la décennie
des
années Cinquante ? Les plaines littorales ont
été assainies par les
troupes américaines, les conditions d’exploitation
sont donc désormais bonnes,
et pourtant rien ne bouge. Les mutations de
propriétés, à cette époque,
ne
montrent aucun mouvement de descente vers les terrains agricoles de la
côte,
hormis le mouvement de long terme de descente vers les piaghje.
Où en situer les
responsabilités ? Sans doute,
ces politiques de développement suscitent des demandes de
participation qui
restent pour l’essentiel insatisfaites mais on est loin
d’une mobilisation des
Corses en faveur du développement agricole de
l’île. Les demandes restent
exceptionnelles et les dossiers sont mal défendus autant que
mal instruits.
Du
côté du
développement du tourisme, cette activité,
à en juger par l’orientation du Plan
d’Action régionale de 1957, qui prônait
une politique intensive, s’est orientée
à travers la SETCO vers le déploiement
d’une infrastructure hôtelière et de
villages de vacance, plus que vers l’agritourisme ou tout
autre formule plus
respectueuse du caractère authentique de
l’île qu’on souligne à
longueur de
rapport, à commencer par celui du Hudson Institute
d’inénarrable mémoire. Il
est vrai que la Corse a attiré dès le XIXe
siècle de nombreux voyageurs de
marque tels des écrivains comme Flaubert,
Mérimée, Maupassant, Balzac, Alphonse
Daudet, Joseph Conrad, Julien Gracq, ou des souverains comme
Édouard VII
d’Angleterre et l’impératrice Sissi,
à tel point qu’un syndicat d’initiative
était inauguré dès 1877. Mais si une
ville comme Ajaccio fut lieu de
villégiature hivernal ou Bocognano lieu de
fraîcheur estival, apprécié des
Anglais, sans compter la vogue des bains de Guagno, la Corse
n’eut pas le même
destin que la Côte d’Azur ou la Riviera et,
après guerre, elle souffrait d’un
déficit en équipement tel que la
capacité en lits ne permettait d’accueillir
dans les années Soixante que 500 000
résidents soit un gros doublement
de la population de l’île.
L’expérience
de la SETCO fut un semi échec en ce qu’elle se
cantonna
à accompagner la
construction de trois établissements mais cela servit de
relais
pour des
opérations immobilières privées. Les
travaux
d’infrastructure furent supportés
par l’État et les collectivités
locales, sans
garantie de conservation du
patrimoine naturel, et sans désenclavement de
l’intérieur de l’île, mais
bien
au contraire en provoquant une accélération de la
dichotomie de développement
entre les pièves de l’intérieur et
celles du
littoral. Les ensembles
touristiques en question, qui ne se développèrent
qu’à la fin des années
Soixante, ne profitèrent pas aux Corses, hormis quelques
emplois
saisonniers,
et demeuraient sans effet sur le développement de
débouchés pour l’agriculture
locale (le ravitaillement est importé). A travers les
critiques
de
« baléarisation »,
largement
partagées à l’intérieur de
l’île, c’est
la perte de soi qui est dénoncée, la
confrontation avec
un monde moderne
uniformisateur et peu respectueux des terroirs qui est
redoutée.
Si les
protestations rejoignaient les préoccupations
écologiques
des années
soixante-dix, le tourisme diffus et respectueux de
l’environnement mit du temps
à s’imposer, et il ne le fait qu’au
travers
d’institutions, plus qu’au travers
d’initiatives, comme d’habitude dans
l’île.
Ainsi, peut-on citer la création,
en 1971, du Parc Régional Naturel, comprenant 150 000
hectares
de terres ainsi
que la réserve marine de Scandola. Tout cela, encore
aujourd’hui, reste bien
timide, car si des chemins de randonnée furent
créés en nombre, le
maillage de
l’agritourisme (le système
des gîtes) reste très
en-deçà de ce qui est pratiqué dans
d’autres régions, il
suffit d’essayer de louer un gîte rural dans
l’intérieur de l’île en
pré-saison, pour s’en convaincre.
Aujourd’hui, deux millions de visiteurs permettent
d’espérer de dégager un PIB
de 300 millions d’euros en 2004, soit 10 % de la valeur
ajoutée totale de l’île
(et 12 % de l’emploi en haute saison).
Le tout
tourisme n’est pas la seule et unique réponse, et
c’est contre une réponse
prônant la bi-activité (tourisme et agriculture
intensive) que l’opinion corse
(et pas seulement les autonomistes) se raidit. Dans le
passé, où l’option ethno-nationaliste
ne faussait pas le débat, la volonté de
défendre le patrimoine ancestral a
groupé les énergies contre des projets
malencontreux comme le projet de centre
d’expérimentation nucléaire
d’Argentella en Balagne, ou des pratiques
insultantes comme le déversement en mer
tyrrhénienne des déchets chimiques
d’une usine de la Montedison, entreprise italienne prenant la
Corse pour une
poubelle ! Les premières actions
d’éclat datent de ce moment, en 1970.
Si les
errements du tourisme égratigna la conscience corse, si la
légèreté des projets
nucléaires ou les pratiques chimiques de tel ou tel eurent
le don d’exaspérer
tous les insulaires, du côté du discours
« corsiste », rien ne
vînt
renforcer autant le mythe de la colonisation intérieure que
les pratiques de la
SOMIVAC à l’occasion du retour des
Rapatriés d’Algérie. Pourtant
l’intention était bonne (mais
l’Enfer…
n’est-ce-pas ?), qui était de promouvoir
un mouvement de modernisation
économique conforme à l’esprit du
traité de Rome en donnant les moyens de revitaliser
l’agriculture avec un programme décennal de
rénovation des infrastructures, de
défrichement et d’irrigation. L’arrivée
des rapatriés
dotés d’expérience professionnelle et
de capitaux va se révéler être un
détonateur lorsque des aides accompagnées
d’un moratoire sur les dettes leur furent
attribuées, notamment s’agissant de lotissements
de la plaine orientale
originellement destinés aux Corses.
Qu’il
nous soit permis de faire
ici un bref aperçu de l’incompréhension
des enjeux
à la fin des années
cinquante et au début des années soixante. En
1957,
près de 20000 ha furent
récupérés en plaine orientale qui vont
faire
l’objet de travaux d’envergure par
la mise en place d’infrastructures,
d’électrification, de traçage de
chemins
ruraux par les collectivités locales tandis que la SOMIVAC
prenait à sa charge
l’irrigation, l’assainissement et le
défrichement,
les subventions couvrant les
deux tiers des coûts engagés. Contrairement
à ce
qui a été dit et écrit, les
lots n’étaient nullement
réservés aux
rapatriés et les insulaires auraient pu y
trouver leur place s’ils s’étaient
manifestés
avec un peu plus de
détermination. Or sur les 3300 premiers hectares de terrains
conquis sur le
maquis peu furent préemptés par les locaux qui ne
croyaient pas à la réussite
de l’opération ou qui manquaient et de capitaux et
d’expérience technique.
Néanmoins avec le temps certains insulaires
commencèrent
à se mettre sur les
rangs. A Ghisonaccia, les lots attribués revinrent
à 43
insulaires et 22 Corses
rapatriés pour 36 rapatriés non Corses. Le
mouvement
enfin lancé, de nombreuses
propriétés tombées en
déshérence
furent récupérées sur le maquis, en
plaine ou
sur le piémont. Par ailleurs de nombreux Corses
trouvèrent très opportun de se
débarrasser des
propriétés en indivis pour
des baux de longue durée dans diverses pièves,
ainsi à Porto-Vecchio mais aussi
sur l’autre versant de l'île, à Sartène, par
exemple. Sur ces nouveaux territoires, les
rapatriés furent les premiers défricheurs sans
attendre l’aide de la SOMIVAC.
C’est alors que plusieurs centaines d’insulaires
commencèrent à déposer des
dossiers, souvent avec succès, provoquant l’afflux
de capitaux urbains (BTP,
commerce, professions libérales) vers les
campagnes : on est loin
effectivement de l’attribution de bonnes terres à
des agriculteurs corses, et
une grande part de leur éviction du marché
rentable de l’agriculture intensive
tient autant à l’entrée sur le
marché foncier de familles corses urbaines qu’au
traitement de faveur dont auraient
bénéficié les rapatriés,
traitement dont on
a pu mesurer les limites. Ainsi, une frange importante de la population
rate le
coche du développement agricole.
Malgré
tout, le niveau de vie s’élève mais
reste un
phénomène urbain plus lié, au
régime d’économie assistée,
le
développement économique réel de
l’agriculture
intensive restant une affaire étrangère
à la
population autochtone.
L’agriculture décline encore : en
près de
vingt ans, de 1957, année de
lancement du Plan à 1975, année des
événements d’Aléria, le nombre des
exploitations est presque
divisée par deux (de 12 280 à environ
7 000). Nous ne reviendrons pas sur
des événements largement connus depuis Aleria
à propos du scandale du vin, à
savoir la pratique de la chaptalisation à outrance
par
des viticulteurs pieds-noirs, ni sur l’occupation de la cave
Depeille et le
drame qui s’en suivit. Il suffit de savoir que si cet
événement donna un coup
d’accélérateur à la mouvance
autonomiste, l’attention désormais
portée sur la
petite île n’amena pas
d’amélioration qualitative dans le
développement économique
qui reste aléatoire. Depuis longtemps,
la modernisation de la Corse a été le fait
d’un modèle de régulation dans
lequel l’État joue un rôle central : les
pouvoirs publics y assurent une part
majeure des revenus et de l’emploi ; l’essentiel
des activités économiques et
sociales y est, directement ou non, subventionnée. Dans un
tel contexte,
l’accès aux ressources sociales dépend
de l’insertion dans les réseaux du
pouvoir politico-administratif local. Les accusations de colonialisme
intérieur que nous allons
explorer s’appuient sur ces errements mais la suite, et
jusqu’à aujourd’hui,
montre que les
raisons de la crise sont
plus banales. Oui, vraiment banales, et où les Corses avant
les autres, ont leur
part de responsabilité.
La trahison des Pieds-Noirs, le
réveil
corse et le retournement du discours
Dans
les années cinquante, la prise de conscience des
difficultés économiques
s’effectue à l’occasion des menaces sur
la pérennité des liaisons ferroviaires,
et donc le maintien d’un service public. La question
foncière ne mobilise
toujours pas réellement et l’on s’en
tient à des protestations
d’intérêts
économiques et sociaux. En 1963, la création
à Paris de l’Union Corse -
l’Avenir présente un aspect plus politique, de
tendance socialisante. Le 1er
congrès de l’union des étudiants corses
(qui ratisse large, des bonapartistes
aux communistes !) propose un programme
régionaliste. L’année suivante, le
“Comité d’Etude et de Défense
des Intérêts de la Corse” (CEDIC) dont
l’un des
co-fondateurs est Max Siméoni, a pour ambition
d’obtenir un statut fiscal
dérogatoire pour compenser
l’insularité ; en 1966, l’Union
Corse et le
CEDIC fusionnent en un “Front Régionaliste
Corse” (FRC) d’inspiration
socialiste, mais le CEDIC demeure comme entité autonome en
raison de
divergences substantielles, ce qui finit par aboutir à la
création de l’Action
Régionaliste Corse (ARC) en 1967, qui maintient
l’exigence d’un statut
particulier (insularité et préservation de
l’identité corse).
L’arrivée
des Pieds-Noirs, on le sait, a été
l’événement qui a provoqué
la
cristallisation des revendications vers plus d’autonomie et
de préservation de
l’identité, et non plus seulement une
défense régionale des
intérêts
économiques et sociaux. L’installation des
rapatriés d’Afrique du Nord se
manifeste massivement en 1962 avec l’indépendance
de l’Algérie mais, dès 1957,
des colons avaient acheté des terres, et jusqu’en
1965 on dénombre 17 500
arrivants, soit environ 10 % de la population de
l’île. Contrairement à ce
qu’on croît souvent, l’accueil ne fut pas
hostile et est plutôt vécu comme un
retour des fils (25 % des arrivants portent un nom corse et la plupart
de ces
Corses sont nés dans l’île). A
l’époque, ces arrivants ne sont pas
perçus comme
des allogènes mais c’est le flux croissant et le
fait de pouvoir louer ou
acheter les lots réservés de la plaine orientale
et les mises en valeur
financées par la SOMIVAC qui provoquent la
méfiance et bientôt la rancœur. En
outre, ces Pieds-Noirs, à peine chassés
d’Algérie, ont l’outrecuidance de
réussir là où les Corses
n’ont pas essayé. Le “miracle de la
Mitidja corse”
suscite le rejet et le bon accueil du début laisse place au
soupçon de la
“colonie de peuplement” ou du colonialisme
intérieur. Cette appréciation est
d’autant plus renforcée que d’aucuns
s’aperçoivent que certains avaient
déjà
pris pied sur l’île bien avant l’indépendance
algérienne qu’ils sont donc
soupçonnés d’avoir anticipée. Les partisans
de l’Algérie Française,
militants OAS en tête, de retour dans
l’île, vont découvrir que, non seulement
ils ont été trahis par la France avec le
« lâchage » de
l’Algérie,
mais que les Pieds-Noirs pour lesquels ils
s’étaient battus ne croyaient pas
eux-mêmes à la Grande France. Dès lors,
les intellectuels « Algérie
Française » vont retourner contre la
France le discours du FLN algérien
qu’ils connaissent bien pour l’avoir combattu. Et,
de fait, dès 1965, on
dénombre treize attentats, trois ans plus tard, 35
attentats. En 1968, apparaît
« Corse libre »
première organisation à
se réclamer publiquement de
l’indépendance. Dans les années
Soixante-dix, les mouvements corsistes se radicalisent,
après le
scandale des
boues rouges (les déversements de produits chimiques de la
Montedison), tandis
que plusieurs mouvements sont créés sur une ligne
plus
nettement
indépendantiste que celle de l’ARC ou
même du FRC,
tels le “Front Paysan Corse
de Libération” dans le sud qui exige
l’expulsion des
« colons » de la
plaine orientale, la corsisation des emplois publics et
l’enseignement
obligatoire du corse dès l’école
primaire.
C’est cette organisation qui
inaugure les « nuits bleues » le
3 janvier 1974.
En février 1974, le
“Parti Corse pour le Socialisme” (PCS)
apparaît sur
la scène politique et prône
ouvertement l’indépendance en proposant de
créer
une plateforme commune
d’action à travers un “Front de
Libération
Nationale” où la référence
à
l’Algérie est transparente. Un
troisième groupe,
“Ghjustizia Paolina” entre en
lice de façon spectaculaire avec le plasticage le 22 mars
1974
d’une caravelle
d’Air Inter sur l’aéroport de Bastia. Le
nombre des
attentats double tous les
ans entre 1973 et 1975. L’ARC dont l’action
réformiste est sévèrement
critiquée
radicalise ses positions en dénonçant la fraude
des
viticulteurs pieds-noirs et
lance un commando sur Aleria. La suite est connue et, en 1976, le FLNC
se
constitue autour du PCS, du Front Paysan Corse de Libération
et
de Ghjustizia
Paolina.
Sur
le plan idéologique, le ressentiment contre
l’invasion pied-noire se transforme
en une critique du colonialisme intérieur, et prend
l’Algérie comme référence
parce que les acteurs de la pièce sont les mêmes
qu’en Algérie : les
vilains pieds-noirs d’un côté, et les
OAS reconvertis dans la lutte de
libération nationale de l’autre, un peu
à la manière des cadres FLN qui avaient
fait leurs classes dans l’armée
française, notamment pendant le conflit
indochinois. Mais comparaison n’est pas raison et le mythe
colonial demande à
être visité.
La Corse est-elle pour autant une
colonie ou
seulement une région à la
traîne ?
L’accusation
de colonialisme intérieur, formule qui eut son heure de
gloire dans les
réflexions tiers-mondistes des années Soixante,
repose sur des approximations
que les faits mettent en difficulté, voire, parfois, sur des
mythes purs et
simples, car retard de développement n’est pas
synonyme de situation coloniale.
Tout
d’abord,
qu’en est-il historiquement des colonisations
avérées ? Si nous nous en
tenons à l’histoire récente et
à la colonisation de l’Afrique, dans un premier
temps, l’Etat s’est souvent reposé sur
des sociétés concessionnaires, à
l’image
des compagnies des Indes au XVIIè siècle,
ou comme la
Compagnie Française de l’Afrique
Occidentale. La France est au mitan de sa mutation
industrielle, elle a donc besoin de matières
premières à un moindre coût ;
elle veut aussi écouler sa production et les
colonies présentent d’indéniables
perspectives de débouchés. En
conséquence,
les colonies pourvoyeuses de matières premières
ou de biens de première
transformation et clientes de biens d’équipement
ne feront pas l’objet de plan
de développement industriel. Si la Corse ne se
développe pas industriellement
ou même voit son décollage industriel
arrêté net, elle ne le doit pourtant pas
à une logique d’exploitation coloniale. En effet,
la France compte peu sur elle
pour lui fournir des matières premières, que le
faible rendement et la faible
production ne rendent nullement profitables, et où
l’activité de transit
douanier est combattue par la réglementation
douanière de 1818. La Corse n’est
pas davantage un débouché au sein d’un
ensemble national protectionniste, en
effet sa faible démographie ne peut constituer un
encouragement pour
l’écoulement de biens de consommation et son
développement industriel ne peut
se prévaloir de constituer un débouché
attractif pour les biens intermédiaires
et les biens d’équipement. L’autre
caractéristique des colonies est d’avoir
été
des lieux d’expulsion des indésirables, soit par
le départ forcé comme en
Algérie (1848) ou en Nouvelle-Calédonie (1871 et
la relégation des Communards),
soit par le travail forcé au bagne (Guyane). Rien de tout
cela en Corse. Enfin,
le droit colonial refuse la citoyenneté au profit
d’un statut de l’indigénat
qui comportait des obligations en nature. Ainsi,
l’indigène devait payer à
l’Etat un impôt qui, dans ces économies
non monétaires, se traduisait par des
journées de travail qui atteindront
jusqu’à six semaines dans certaines
colonies (Madagascar). Est-il besoin de préciser que les
Corses ne furent
jamais soumis à une telle réglementation,
qu’ils furent des citoyens à part
entière, qui plus est, souvent appelés
à exercer les plus hautes fonctions de
l’Etat ?
Parlons alors
de la spoliation des terres et de son corollaire, la non reconnaissance
des
droits fonciers des sociétés
colonisées, bien que sur ce point, il faudrait
être nuancé ; ainsi, en
Algérie, des biens fonciers incultes furent
souvent mis en valeur par les colons .
Mais
s’agissant de la Corse, personne ne s’est
intéressé au foncier insulaire avant
la fin des années cinquante. Et, il s’agit moins
d’une spoliation de terres
communes qui intéressaient peu, que de conditions
avantageuses qui furent
faites alors dont on suppose qu’elles auraient pu
intéresser les Corses. Quant
à la privatisation de communaux que cela suppose elle
n’est rien de plus que ce qui s’est toujours
pratiqué à travers les abus de
clôture sur le Continent ou l’extension de la
propriété arboraire en Corse,
mais cette fois à destination de plusieurs
bénéficiaires et non d’une seule
famille. En outre, ce furent surtout des terres en
déshérence ou des
propriétés
indivises qui furent visées.
Une seconde
phase de l’ère coloniale s’ouvre au
lendemain de la première guerre mondiale où
l’on découvre le sort des Africains et la faillite
des société
concessionnaires. La nouvelle politique coloniale est celle des grands
travaux
de mise en valeur et de développement des infrastructures,
à l’aide du travail
forcé, avec, en Afrique équatoriale, un
coût humain impressionnant (on parle de
20 000 morts dans les zones paludéennes),
coût si exorbitant qu’un plan
sanitaire est mis en œuvre. Cette situation, les Corses ne la
connaîtront
jamais.
Au lendemain
de la seconde guerre mondiale, les Etats s’impliquent encore
plus dans le
développement et l’effort
d’équipement dans les infrastructures,
l’éducation,
les usines de transformation. Mais la comparaison avec la Corse qui
bénéficie
également de plans de modernisation
s’arrête là. En effet, les anciennes
colonies souffrent d’un sous-développement
chronique lié aux conditions
d’échanges inégalitaires, avec une
croissance du PIB inférieure à la croissance
démographique. En Corse, c’est
l’inverse, la croissance démographique est due
à
l’immigration pour l’essentiel mais pour autant la
croissance de la valeur
ajoutée reste supérieure et, mis à
part les années creuses de 1993 à 1996, le PIB par tête
croît à un taux satisfaisant,
souvent supérieur à celui de la moyenne
provinciale ou même nationale.
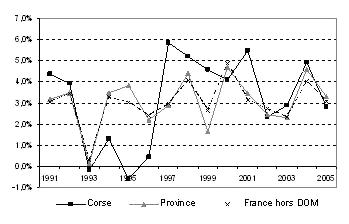
Source :
INSEE 2005 (deux dernières années
estimées)
Quant
à la
colonisation de peuplement, certes les Arabes sont nombreux mais les
Français (les pinzuti)
sont soit des conjoints de
Corses (faut-il trancher au sein des familles ?) soit des
agents des
services publics qui ne font que passer. En outre, dans ce dernier cas,
la
corsisation des emplois publics sur l’île
relève de l’incantation que la
situation réelle rend ridicule. En effet c’est
d’ores et déjà une
réalité
tangible : les emplois publics territoriaux et hospitaliers
font la part
belle aux autochtones depuis des années et, en ce qui
concerne la fonction
publique d’Etat, la Corse est une destination
déficitaire dans tous les
tableaux de mutation des administrations.
A
titre illustratif, l’annuaire du Rectorat présente
une proportion de 75 % de
patronymes corses... Les Corses du continent veulent-ils
revenir ? Le
veulent-ils, avant la retraite ? Le veulent-ils même
après (le séjour
au village passe rarement la date de la Toussaint) ? La Corse
connaît en
ce début de siècle un taux solde naturel de 0,02
% contre 0,36 % pour la France
entière ;
les Corses ne font plus d’enfants, et si, selon les
projections de l’INSEE, en
2030, la Corse approche les 300 000 habitants ce sera par
l’effet des
migrations, et cet effet seulement. Sans cet apport
extérieur, la Corse meurt
plus sûrement encore en perdant 14 000 habitants par
rapport à la
situation d’aujourd’hui. Allons plus loin, boutons
les Français et les Arabes
dehors, les Corses du Continent viendront encore moins, certains Corses
de
l’île partiront (suivre leur conjoint
expulsés)… une Corse de retour au chiffre
du début du XIXè siècle
(150 000 habitants) ?
Pour conclure
ce chapitre, notez que le refrain qui est repris en cœur par
les insulaires, et
pas uniquement les séparatistes (s’il en existe
vraiment), est celui d’une
bonne volonté corse systématiquement contrainte
par une volonté extérieure,
particulièrement maligne, celle de la marâtre
patrie. Or pendant les vingt-cinq dernières
années, de nombreuses
structures de financement et de développement furent
créées. Mais sans réel
résultat. Tout d’abord, la Caisse de
développement agricole (CADEC), véritable
tuteur économique fit faillite et fut remplacée
en 1999 par l’Agence de
développement de la Corse (ADEC), tandis que la Caisse
régionale du Crédit,
agricole autre grand bayeur de fonds était en
difficulté. Rien
n’y fait ni s’y fait, malgré les
subventions de l’Etat
et de la Communauté européenne, les handicaps
naturels de l’île sont là :
le manque de matières premières et leur faible
rendement, un espace exploitable
restreint qui explique plus la faible densité que les
méfaits supposés de la
présence française, un relief
tourmenté (l’altitude moyenne y est plus
élevée
que dans les Alpes, avec 10 % de superficie en plaine ou moyenne
montagne).
Le carcan
d’une économie insulaire à faibles
ressources et
marché étroit favorise la concurrence
extérieure et l’a toujours favorisée
plus
que toute loi douanière.
Mais ce
n’est
pas tout ; il n’y a pas que
l’île en cause, ceux qui y habitent ont leur
part de responsabilité, en présentant tous les
symptômes de résistance
psychologiques et politiques à l’aventure de la
libre entreprise. C’est une île
dont la démographie déprimée et
vieillissante n’autorise que peu de
débouchés
sur le marché local et où la main
d’œuvre qualifiée est insuffisante. La population
active est en bonne partie composée de fonctionnaires territoriaux.
L’encadrement manque
cruellement et l’on peut s’interroger sur la
pertinence des choix pédagogiques passés
de l’Université de Corte qui cantonnait ses ouailles
dans la formation littéraire
ou juridique, laissant la technique et le commercial aux
Universités du
Continent vers qui les étudiants ambitieux
s’orientent pour ne plus revenir. Et ce
n’est pas fini ! Que dire de la réticence
à vendre
la terre héritée des parents, avec pour
conséquence un taux d’indivision
affectant 47 % du territoire, ce qui gèle des
terrains cultivables et
limite la transmission des capitaux. Précisément,
à ce manque de capitaux, s’ajoute la seule
perversité de la marâtre
patrie que je reconnais, savoir
les aides de l’État qui maintiennent un niveau de
vie artificiellement élevé et
favorisent la consommation au détriment d’une
économie productive. Une économie
d’assistés et non de colonisés,
voilà le vrai visage de la Corse.
 |
C’est
une histoire de mythes et d’identité : la question
corse
qui fait souvent l’actualité
a tordu la mémoire des faits. Le tout
grâce
à la
réécriture de l’Histoire de
l’île et à la mythologisation de
la langue
|
 |
Allons
plus loin déshabillons le paon pour découvrir le
poulet qui est
dessous. La Corse fut-elle le phare des Lumières ? Y-a-t-il
eu une
Corse vraiment indépendante et que voulaient les Corses sous
Paoli ?
|
 |
La
Corse s’est ralliée. A-t-elle combattu ? La Corse
eut-elle un comportement
si différent des autres provinces de la
République française ? Le
ralliement fut-il facile ? A-t-elle cru se découvrir un
destin ?
|
 |
La
petite île a-t-elle voulu donner des gages ? S'est-elle
imaginé un
Empire par
procuration ? Lors de l'occup', fut-elle exemplaire ? A-t-elle des
leçons
à donner ?
|
 |
Une
fois l’Empire colonial effondré, que
devient la petite île ? Veut-elle s’en retourner
à son passé glorieux
mais confisqué et veut-elle enfler ses mythes pour les
vendre à l'encan ?
|
 |
Les
mythes se portent bien, ils se sont même diffusés
partout. Faut-il en
rester là et faire du chantage à la Dette ? Ou
bien, au contraire,
est-il possible que l'île envisage de sortir du mythe et arrive à affronter la
réalité du monde moderne ?
|
|
|



